Le présent Descriptif Technique & Scientifique (DTS) précise le détail des travaux à réaliser dans le cadre de l’Etude IFC-IST pour la spécification d’un formalisme IFC destiné à décrire les ouvrages et équipements d’une infrastructure souterraine (IST) intégrée dans son environnement naturel. Ce projet s’inscrit dans le contexte de la démarche BIM mise en œuvre pour le développement d'une phase PRO, en incluant les phases « transitoires » : fin d’AVP / début PRO et fin PRO / début Etude d’EXécution. Il propose également d’étendre le périmètre classique du BIM et s’intéresse à la modélisation de l’environnement de l’IST et des interactions ouvrages / environnement, et tout particulièrement des informations géologiques et géotechniques.Les prestations à réaliser sont au nombre de 6 : D'une part des missions de spécifications (5): - des protocoles d'échange d'informations (IDM, Information Delivery Manual) ; - d’un dictionnaire de données (DD, Data Dictionary) pour préciser la sémantique des informations échangées ;- des entités nouvelles (ou amendées) requises pour décrire le modèle de données (IFC, Industry Foundation Classes) ; - des seules entités autorisées (restriction) pour décrire les informations d'un protocole d'échange associé à un cas d’usage donné (MVD, Model View Definition) ; - d’un protocole d'accord pour l'intégration des travaux dans la normalisation internationale BIM et OGC (MOU, Memorandum Of Understanding). D'autre part une mission de réalisation (1) : -du développement d'un transcodeur IFC (bibliothèque DLL, Dynamic Link Library) portant sur les nouvelles entités requises et permettant à des logiciels métier d'importer / d’exporter des fichiers d'échange au format IFC les contenant. Ces prestations seront déclinées selon 2 sous-projets principaux : - celles concernant les ouvrages et équipements d’une infrastructure souterraine ; - celles liées à la modélisation de l’environnement naturel, intégrant les données géologiques et géotechniques. Elles viseront à permettre d’assurer 26 cas d’usages principaux du BIM et de la maquette numérique, identifiés à ce stade et qui pourront être complétés/modifiés au démarrage de l’étude. Ces cas d’usages, extraits d’une approche de démarche BIM d’une maitrise d’ouvrage, ne sont pas à considérer comme un objectif à court terme de livrable de la présente étude, mais plutôt comme un guide des « filtres » d’échanges d’information qu’il sera possible d’intégrer pour les postes « MVD ». En ce sens, pour une phase PRO d’un projet d’infrastructures souterraines, la totalité des cas d’usages envisagés ne sera peut être pas tous adaptée. Il s’agira donc de faire un « tri » et d’en faire le plus possible, lorsque cela s’avérera nécessaire.Il est également précisé, qu’à terme, la profession espère pourvoir bénéficier d’un standard interopérable pour toutes les phases d’un cycle de vie : de la programmation au démantèlement, et pour l’ensemble des types d’ouvrages (Terrassement, VRD, Bâtiments conventionnels, Bâtiments non conventionnels, Installations spécifiques, etc.). Cependant, à court terme, le périmètre de l’Etude IFC-IST a été « restreint » d'une part aux ouvrages et équipements d’une infrastructure souterraine, et d'autre part pour une phase PRO.
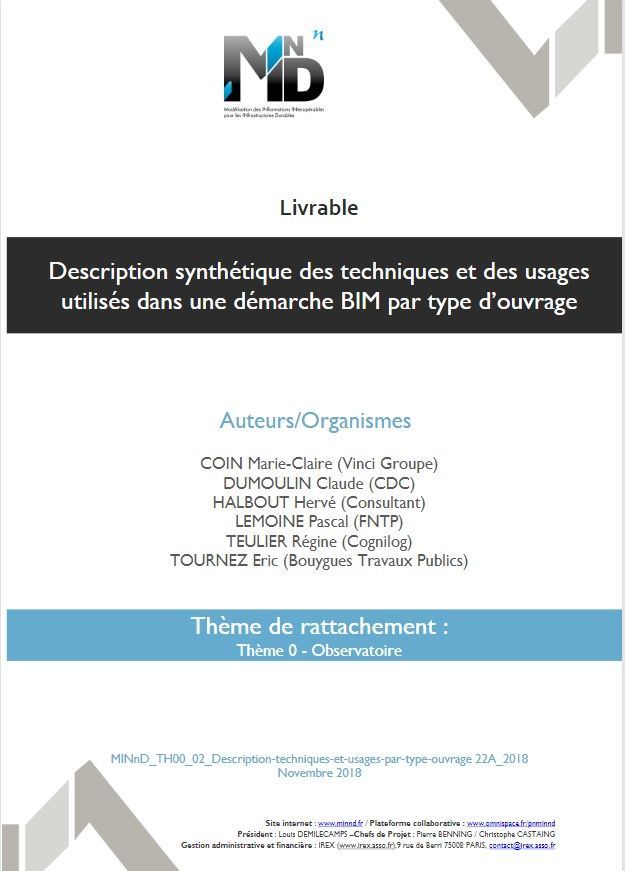


.jpg&w=3840&q=100)







